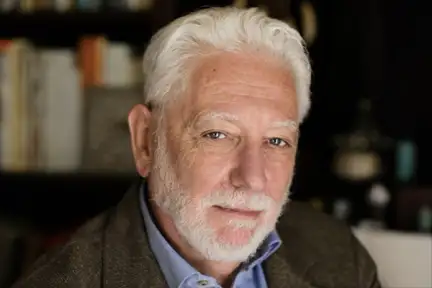Dans le cadre de leurs études, cinq étudiants de Sciences Po Rennes ont pu s'entretenir avec quelques-uns des grands témoins invités aux Champs Libres durant la saison 2022-2023. Le 7 avril, ils ont pu rencontrer Philippe Descola, anthropologue, et Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives et auteur de bandes dessinées.
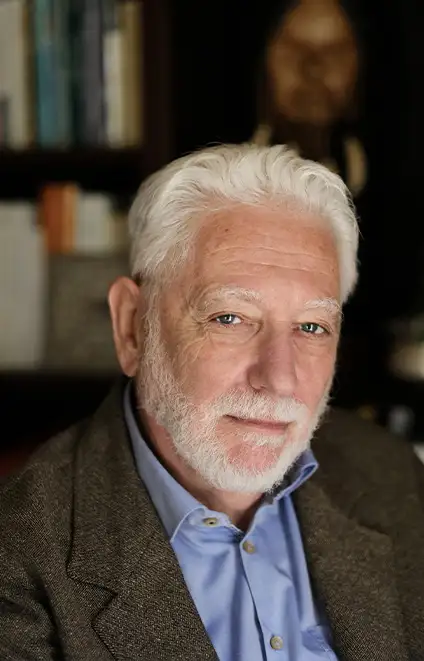
Dans cette entretien, les deux hommes témoignent, en toute liberté, de leur aspiration à de profonds changements dans nos modes de vie collective, en s'appuyant sur leurs recherches et leurs convictions.
Qu'est-ce que l’anthropologie de la nature, ce champ de recherche que vous développez dans vos travaux ?
Philippe Descola : L‘anthropologie de la nature, c‘est un terme oxymorique qui désigne l‘étude des discontinuités entre humains et non-humains, notamment mais pas uniquement le rapport entre nature et société. Pourquoi oxymorique ? Parce que, et j‘ai voulu attirer l‘attention sur ce fait, la nature est nécessairement une construction sociale, c‘est une façon de concevoir les discontinuités entre humains et non humains, qui varie dans le temps et dans l‘espace. Je dis aussi parfois que la nature n‘existe pas, pas pour tout le monde en tous cas.
Qu'il s'agisse de l'exploiter ou de la protéger, vous écrivez que l‘Homme moderne a un rapport utilitariste à la nature. Qu'entendez-vous par là ?
PD : A partir de la révolution industrielle, et même avant, les savants ont vu dans la nature un domaine séparé des humains, pour lequel on pouvait déterminer des lois et utiliser les ressources. Plus exactement, il s'agissait de transformer la nature en ressource. Ensuite, quand on s‘est rendu compte au XIXè siècle que l'utilisation effrénée de ces ressources causait des dommages irréparables, on a compris la valeur et on a cherché à préserver la nature. Les premières zones protégées ont été créées aux États-Unis puis en Europe à la fin du XIXè siècle, mais l'idée était moins de préserver la biodiversité de ces espaces que de conserver une nature vierge, presque biblique, dans un cas, et de préserver des zones de chasse dans l'autre. Le rapport à la nature demeurait un rapport d'utilisation. Ce n'est que plus tard, progressivement, que l'idée de zones protégées fondées sur le principe de la conservation de biodiversité est apparue.
Ce rapport à la nature n‘est pourtant pas universel. Vous le démontrez en évoquant un peuple amazonien, les Achuars ...
Alessandro Pignocchi : C‘est le contraste fondamental dont parle Philippe [Descola]. Il y a un affrontement des cosmologies [1], des façons de voir le monde. Dans la cosmologie naturaliste, celle de l'Homme moderne, les plantes, les animaux, les écosystèmes sont rejetés dans une grande catégorie de la nature auquel on attribue le statut d‘objet. Les milieux de vie sont perçus comme des objets dont la valeur ne tient qu'à l'utilisation que les humains peuvent en faire. Les Achuars d'Amazonie, comme certains peuples du grand nord et de Sibérie, ont en revanche un rapport animiste aux êtres vivants non-humains, auxquels ils attribuent une intériorité, des facultés intellectuelles et émotionnelles du même type que celles des humains. Les Achuars ne voient pas la nature comme une entité extérieure, ils font société avec elle.
On parle de donner la personnalité juridique aux éléments naturels, pour empêcher leur utilisation abusive. Pensez-vous que cela soit pertinent ?
PD : Donner la personnalité juridique à des espèces ou même à la nature en général, comme on l'a vu faire par exemple en Amérique du Sud, semble surtout symbolique mais l‘idée a le mérite d‘annuler le rapport de propriété que l‘Homme exerce sur la nature. L'idée d'attribuer une personnalité juridique à des milieux de vie, qui sont des entités concrètes avec des limites, des propriétés physiques et des habitants, semble par contre plus intéressante. C'est un outil qui, même s'il n'est pas suffisant en soi, pourrait permettre aux milieux de vie d'acquérir la pleine propriété de soi, et donc la capacité à se défendre contre les dommages.
Vous avez tous les deux passé du temps sur la ZAD [Zone à défendre] de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Vous y avez observé la formation de solidarités entre humains et non-humains, unis par des intérêts communs…
AP : En effet, ce qui est à retenir c'est qu'on a vu se former à Notre-Dame-des-Landes une réelle communauté de lutte. Ce qui a sauvé le bocage, et explique que l’État ait échoué par deux fois à tuer la ZAD, c'est que les militants ont développé de tels liens affectifs à leur milieu de vie que l'idée qu'il soit détruit devenait intolérable. Les habitants de la ZAD étaient prêts à faire corps, au sens physique, pour déjouer les projets d‘aéroport.
Et ça fait peur à l'État ?
AP : Oui ça fait peur. On s'en rend compte quand on voit le déchaînement de Gérald Darmanin [ministre de l'Intérieur] contre le mouvement des ZAD, ou les mouvements de la Terre, qui sont minoritaires numériquement mais beaucoup plus menaçants que des manifestations qui regroupent plus d'un million et demi de personnes mais sont parfaitement inoffensives.
Qu'est ce qui dérange tant dans le mouvement des ZAD ?
AP : Ce qui dérange dans les mouvements de lutte, c'est qu'en déployant des formes d'autonomie matérielle sur les territoires, on s'en prend à l'outil de domination premier qu'est le marché du travail. L'affect qui maintient la population tranquille c'est la peur de ne plus pouvoir se nourrir et de ne plus pouvoir se loger. À partir du moment où on se saisit d'un territoire et où on y créé des liens de solidarité et d'entraide qui nous émancipent de la dépendance au marché du travail, on acquiert une puissance politique qui est insupportable pour un État.
Au Chili, à partir de juillet 2021, une assemblée paritaire rassemblant des membres issus de la société civile a été réunie pour rédiger une nouvelle Constitution et remplacer le texte hérité de la dictature d'Augusto Pinochet. Croyez-vous-en ce type d‘initiatives ?
PD : Je crois, en effet, à ce genre d’initiatives qui laissent plus de place à la démocratie participative. Même si cette Constitution a été rejetée et que de nombreux électeurs, progressistes par ailleurs, ont craint que le texte ne redonne un pouvoir politique fort aux autochtones Mapuche, il est intéressant que des citoyens se réunissent pour discuter ensemble du genre d’État dans lequel ils veulent vivre.
AP : Oui, ce modèle est pertinent, au moins de manière transitoire. Même quand on a pour modèle le communalisme, donc un ensemble d'entités autonomes qui fonctionneraient en démocratie directe, on se doute que le changement de modèle ne peut pas advenir d‘un coup. L'important, avec les scénarii de politique fiction qu‘on retrouve notamment dans Ethnographies des mondes à venir, c'est d'insister sur le côté potentiellement désirable de la chose, de mettre en avant ces formes d'organisation politiques plus ascendantes. Même si l'hypothèse révolutionnaire n'est pas à écarter, elle ne doit pas être le seul horizon possible.
Pouvez-vous nous conseiller des références culturelles ?
PD : La peintre américaine Joan Mitchell. Joan Mitchell : la fureur de peindre, de Florence Ben Sadoun ; sous la direction de Laure Adler
AP : Terre et liberté d’Aurélien Berlan.
[1] Théorie (philosophique ou scientifique) de la formation et de la nature de l'hiver ; dans la pensée de Philippe Descola, c'est "une façon spécifique de concevoir les relations entre humains et non-humains" (Pottier, R. (2007). Regards croisés d'un anthropologue et d'un sociologue sur Par-delà nature et culture de Philippe Descola. Revue française de sociologie, 48, 781-793. https://doi.org/10.3917/rfs.484.0781)